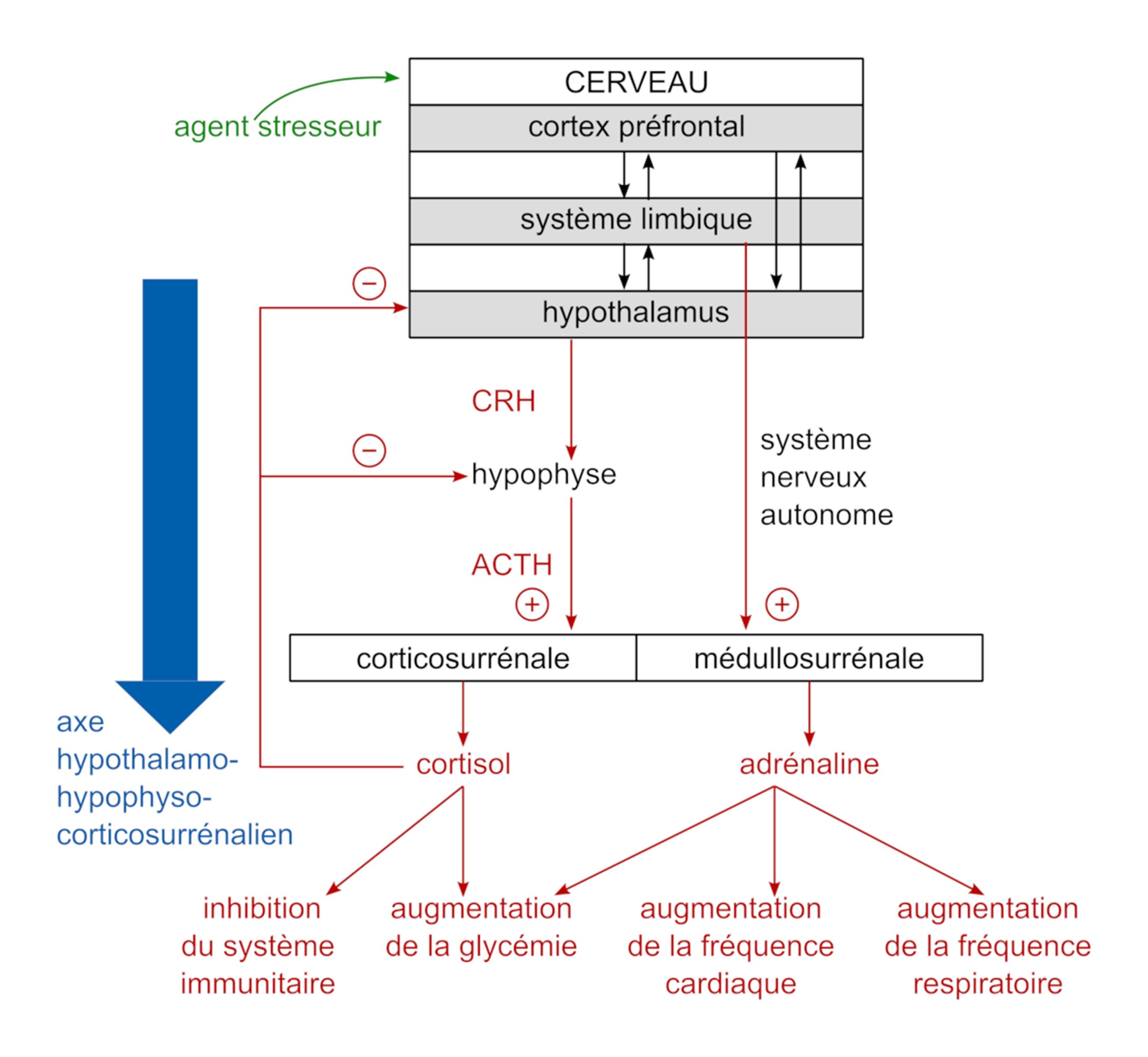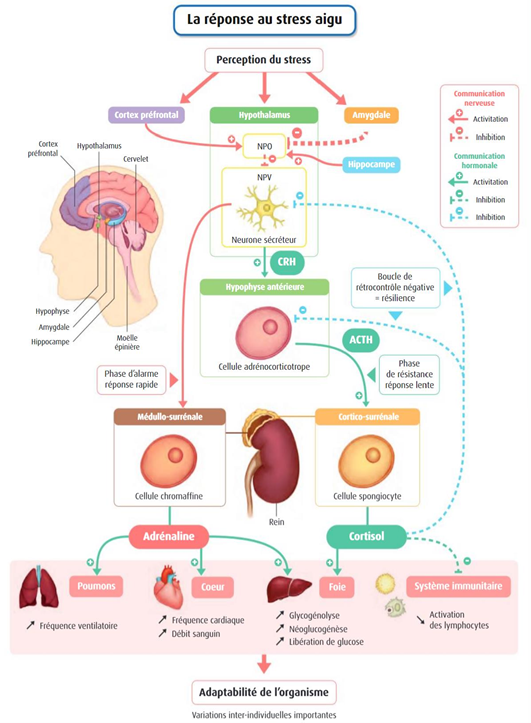Chapitre
1 : L’adaptabilité
de l’organisme
Term spé SVT. Test 51.
Comportement et Stress,
Adaptabilité : La Peur
Dans notre
quotidien nous sommes soumis à des situations
génératrices de stress. Face à ces agressions plus
ou moins importantes, notre
organisme dispose de différentes réponses adaptatives.
Comment notre organisme
répond-il à une
situation provoquant un stress ?
I.
Le
stress aigu, un ensemble de réponse adaptatives
Face aux
perturbations de
notre environnement (= agents stresseurs : d’origine biologique,
physique, chimique mais
aussi sociale), nous disposons de réponses adaptatives. Il
s’agit par exemple
de la dilatation des pupilles, de l’augmentation des
fréquences cardiaque et
respiratoire, de l’augmentation de la concentration sanguine de
certaines
hormones.
Ces réponses sont stéréotypées (=toujours les mêmes) mais leur intensité est variable. Elles permettent de produire un comportement approprié (fuite, lutte, …) en réponse à l’agent stresseur. Le stress aigu désigne ces réponses face aux agents stresseurs.
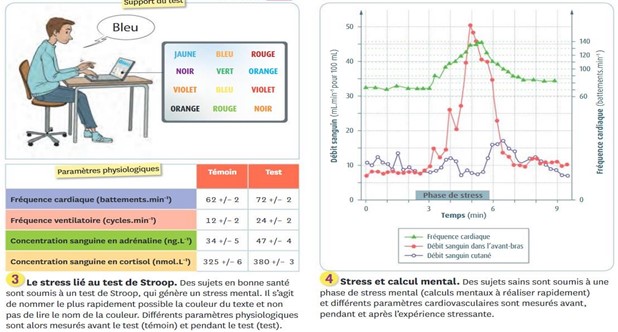
II.
Une
double réponse
hormonale plus discrète
A. La réponse immédiate
à l’agent stressant : la phase
d’alarme
Des
expériences utilisant l’imagerie médicale (IRM) et
des
patients atteints de lésions ont permis d’identifier les
structures du cerveau
et les voies nerveuses impliquées lors d’un stress aigu.
Ainsi, lorsqu’un agent stresseur est détecté (par le cortex préfrontal qui analyse les informations provenant des organes des sens), le système limbique (=ensemble de zones cérébrales impliquées notamment dans la gestion des émotions) est activé. Il comprend entres autres l’amygdale.
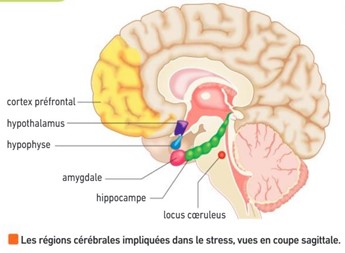
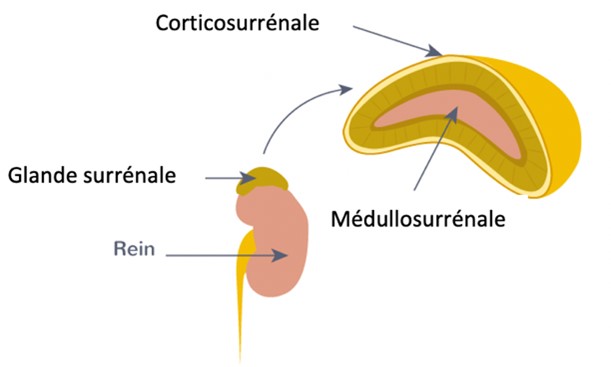
L’activation
de ces structures va se traduire
par la stimulation nerveuse de la partie médullaire
(=interne) des glandes surrénales
(glandes endocrines de forme
triangulaire situées au-dessus des reins) : les médullosurrénales.
Les médullosurrénales
ainsi activées vont libérer dans le
sang de l’adrénaline
seulement quelques
secondes après le début de la situation stressante.
L’adrénaline
est responsable de l’augmentation des fréquences
cardiaque et ventilatoire ainsi que celle de la glycémie.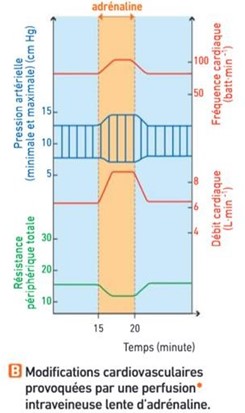
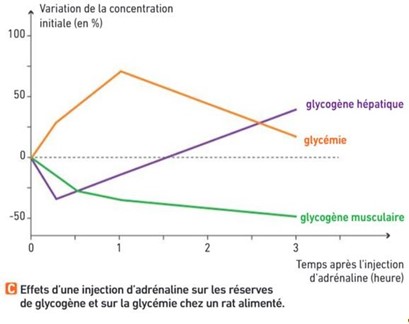
B. La réponse plus tardive
à
l’agent stresseur et le
retour à l’équilibre : la phase de
résistance
L’exposition
à un agent stresseur va
entrainer ensuite une réponse un peu plus
tardive (mise en place
quelques minutes après le début de l’exposition /
contre quelques secondes pour
la sécrétion d’adrénaline).
En effet l’exposition à l’agent stresseur va entrainer la libération de CRH (Corticotropin-Releasing Hormone ou corticolibérine) par l’hypothalamus (plus précisément le noyau paraventriculaire NPV). Cette neurohormone va alors agir sur la partie antérieure de l’hypophyse (anté-hypophyse) qui en réponse libérer une autre hormone l’ACTH (Adreno CorticoTropic Hormone ou Corticotropine)
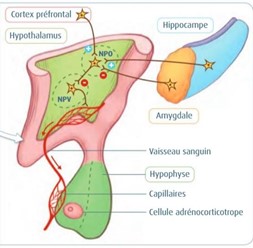
L’hypothalamus
et l’hypophyse appartiennent
au système limbique.
C’est la corticosurrénale
qui est l’organe cible de l’ACTH. Elle va alors
libérer du cortisol
dans le sang. Parmi ses nombreux effets,
le cortisol :
·
Provoque
l’augmentation de la glycémie : il
mobilise les réserves de glycogène et favorise la
synthèse de glucose ;
·
Inhibe
certaines fonctions comme la digestion
ou encore le système immunitaire.
Ces changements physiologiques permettent à l’organisme de réagir face à l’agent stresseur en adoptant un comportement de lutte, de fuite ou d’immobilisation.
D’autre
part, des cellules de l’hypothalamus et de l’hypophyse
possèdent des récepteurs au cortisol. Ainsi le cortisol
produit suite à une
situation stressante va pouvoir se fixer sur ces structures. Cette
fixation
entraine l’inhibition du complexe hypothalamo-hypophysaire qui
libère alors
moins de CRH et d’ACTH. Les corticosurrénales sont alors
moins stimulées et
elles libèrent moins de cortisol.
Ainsi le cortisol limite sa propre sécrétion : on parle de rétrocontrôle négatif. Ce dernier participe à la résilience car il favorise le rétablissement des conditions de fonctionnement durable de l’organisme.
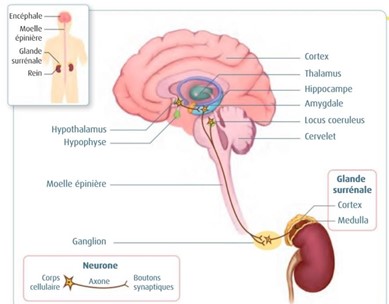
Schéma
bilan de la réponse au stress aigu