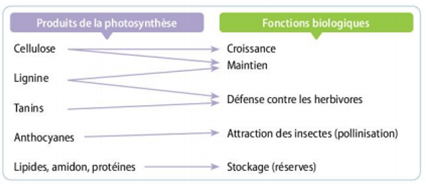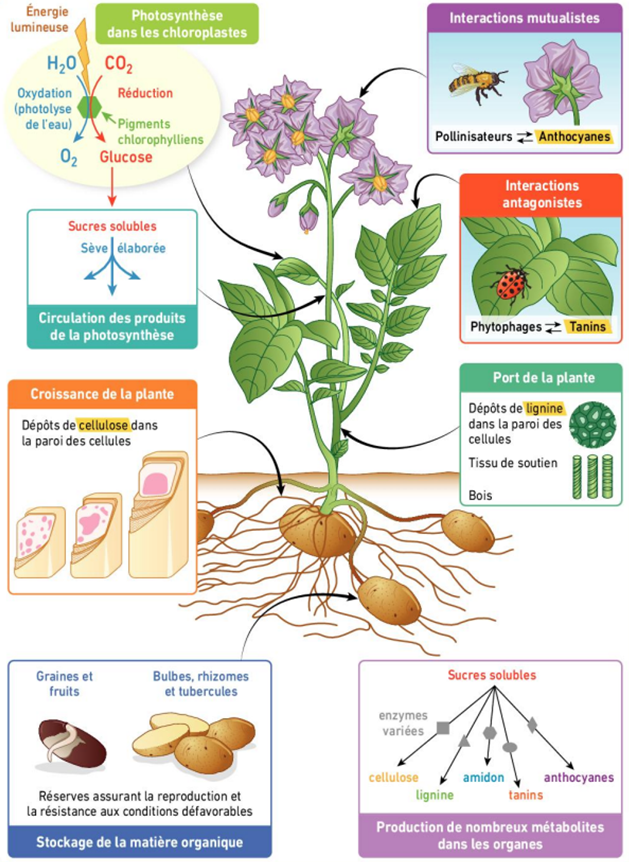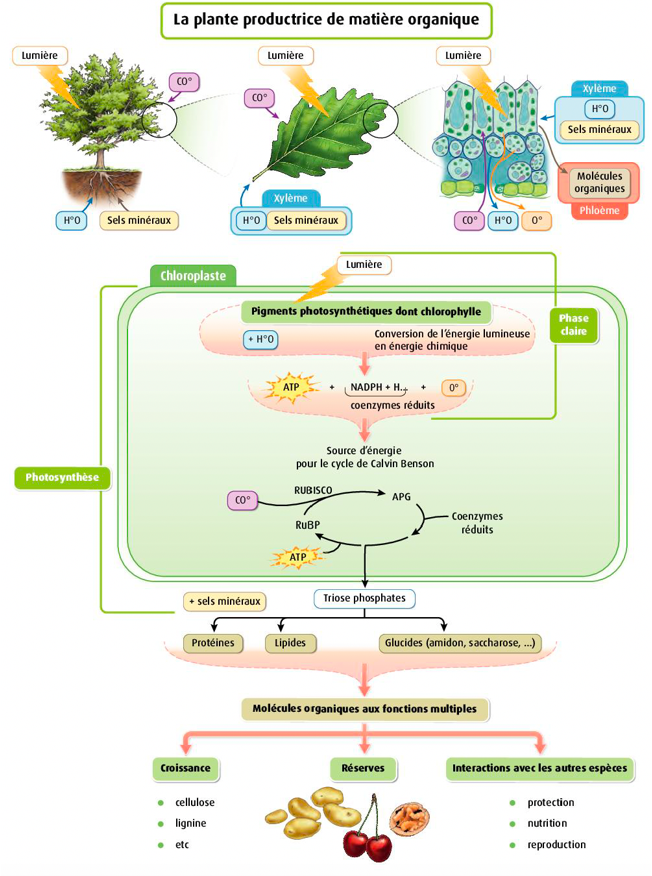I.
Les
structures impliquées dans la photosynthèse
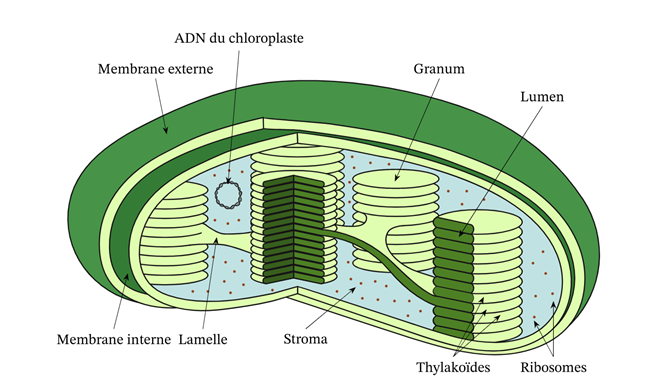
Les
plantes sont capables de produire toutes leurs molécules
organiques (glucides, lipides, protides, acides aminés,
vitamines…) à partir de molécules
minérales, le dioxyde de carbone (prélevé dans
l’air par les stomates), l’eau et les ions minéraux
(prélevés dans le sol et transportés grâce
à la sève brute). Ce sont des organismes autotrophes
qui ont besoin de l’énergie lumineuse
utilisée lors de la photosynthèse.
La
présence d’amidon (une forme de stockage
du glucose) dans les parties vertes exposées à la
lumière peut être mise en évidence. Ainsi la
production de matière organique se fait dans les parties
aériennes et vertes donc principalement au niveau des feuilles.
En effet, dans leur parenchyme, on peut observer des cellules
chlorophylliennes qui possèdent des organites
spécialistes de la photosynthèse : les chloroplastes.
II. Les processus biochimiques de la photosynthèse
A Le rôle de la lumière
Les chloroplastes possèdent des pigments chlorophylliens capables d’absorber l’énergie lumineuse. Il existe différents pigments dont l’absorption des longueurs d’onde de la lumière blanche varie. Ils sont contenus dans la membrane des thylakoïdes des chloroplastes. Ces pigments peuvent être séparés par chromatographie pour distinguer les chlorophylles a et b, les xanthophylles et les caroténoïdes.

La comparaison des courbes représentant la variation de l’absorption de la lumière et de l’intensité photosynthétique en fonction des longueurs d’onde montre une corrélation entre l’importance de l’absorption de la lumière et l’activité photosynthétique. Cette corrélation s’explique par le rôle des pigments (notamment la chlorophylle) dans l’absorption et la conversion de l’énergie lumineuse en énergie chimique utilisée pour la synthèse de molécules organiques (énergie chimique).
B Les réactions chimiques lors de la photosynthèse :
1.
La
phase claire de la photosynthèse : la photolyse de
l’eau
En
1937, Robert Hill constate que si des chloroplastes isolés sont
placés à la lumière ils libèrent du
dioxygène à condition qu’un oxydant (accepteur
d’électrons) soit ajouté dans le milieu. La
photosynthèse s’accompagne donc de réactions
d’oxydoréduction activées par
l’énergie lumineuse. En
1941, Ruben et Kamen montrent que le dioxygène produit lors de
la photosynthèse a pour origine la molécule d’eau.
Les molécules d’eau sont donc oxydées,
libérant du dioxygène mais aussi des protons et des
électrons c’est la photolyse de
l’eau :
La
photolyse de l’eau :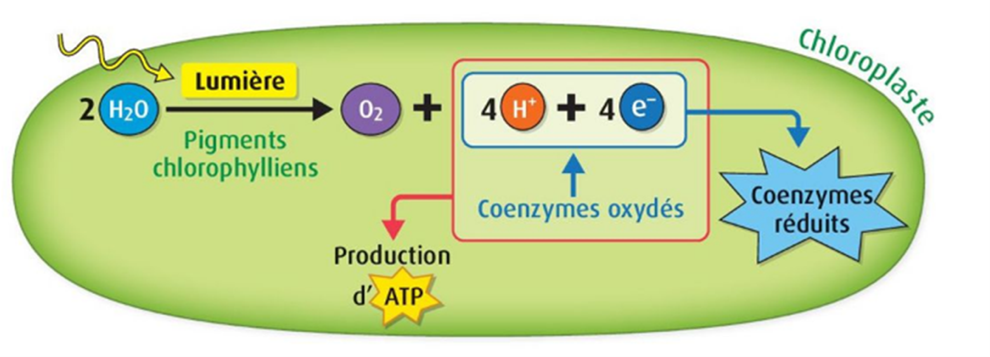
Il
s’agit d’une réaction d’oxydation car
l’eau perd des électrons qui sont
captés par des molécules appelées coenzymes (RH2),
qui passent donc de l’état oxydé à
l’état réduit. Au cours de ce processus de l’ATP
est produit.
2.
Du
CO2 à la matière organique : la phase
sombre ou chimique de la photosynthèse
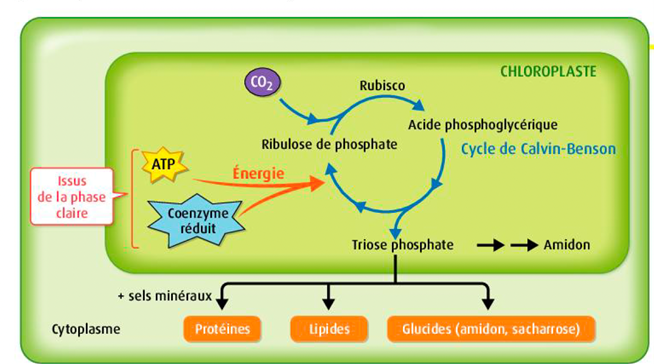
L’ATP
et les coenzymes produits pendant la première phase de la
photosynthèse sont des sources d’énergie chimique
que la cellule va pouvoir utiliser. Dans les années 1950, les
expériences de Calvin et Benson montrent que le dioxyde de
carbone est transformé en différentes molécules
organiques comme des glucides (glucose et autres sucres) et des acides
aminés. A la suite de réactions complexes, il y a une réduction du dioxyde de carbone. C’est le cycle
de Calvin-Benson
Cette
étape ne nécessite pas obligatoirement de lumière
mais est dépendante de la phase claire de la
photosynthèse dans laquelle l’énergie lumineuse est
essentielle. Le bilan de la phase sombre est le suivant :
La photosynthèse correspond donc à une réduction du dioxyde de carbone en matière organique couplée à l’oxydation de l’eau.
III. Le devenir des produits de la photosynthèse
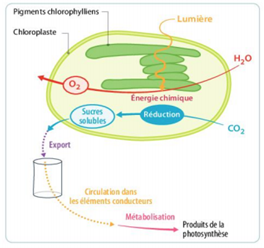
Les
molécules organiques produites par la photosynthèse sont
en partie utilisées par les tissus chlorophylliens et le reste
est exporté sous forme de petites molécules solubles
(acides aminés et sucres) vers tous les organes de la plante,
notamment les organes non chlorophylliens (racines, bourgeons,
fruits…) via la sève élaborée.
Une
fois sur place, les sucres et les acides aminés sont
transformés pour permettre la production d’une grande
diversité de composés organiques qui remplissent de
nombreuses fonctions dans la plante.
B Des matières assurant la croissance et le prt de la plante :
Les
cellules des plantes possèdent une paroi formée de
différents composés organisés en couches
superposées, c’est le cas des hémicelluloses, des
pectines et de la cellulose. Cette cellulose est un
polymère de glucose synthétisé grâce
à une enzyme (cellulose synthase) chez les jeunes cellules en
croissance. Ainsi au cours du temps, leur paroi initiale fine et
déformable devient de plus rigide et épaisse. La paroi
végétale peut-être secondairement
imprégnée de lignine.
Son
accumulation dans la paroi des cellules du xylème les
imperméabilise et facilite la circulation de la sève
brute.
●
Elle
peut également s’accumuler dans un tissu de soutien, le
sclérenchyme fréquent chez les plantes herbacées.
● Chez les plantes ligneuses (de plus grande taille), un xylème secondaire se forme et s’épaissit années après années dans les organes pérennes comme les tiges et les racines. Ce matériau se lignifie et donne un tissu appelé le bois, responsable du port dressé.
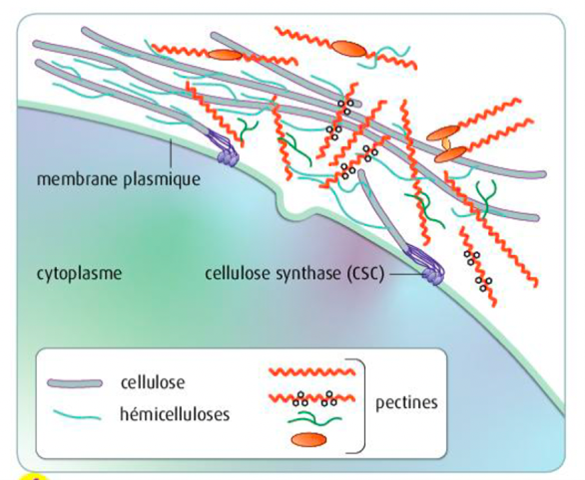
Structure
de la paroi végétale
C Le stockage de la matière
organique
En
hiver ou lors de longues périodes de sécheresse, les
plantes peuvent perdre leurs feuilles ou leurs parties
aériennes. Des organes ont donc été
sélectionnés par l’évolution pour permettre
aux plantes de stocker de la matière organique en attendant le
retour de conditions favorables au développement et à la
photosynthèse.
●
Les
plantes herbacées pérennes possèdent
des organes souterrains comme les bulbes, les tubercules ou les
rhizomes capables de d’accumuler des réserves à
l’abri. Ces réserves sont le plus souvent de nature
glucidiques (ex : amidon stocké dans les amyloplastes de la
pomme de terre).
●
Chez
les plantes annuelles, la pérennité est
assurée par les graines qui contiennent des matières
organiques qui nourriront l’embryon puis la jeune plante. Ces
réserves peuvent être de nature glucidique (blé,
riz) lipidique (noix, amande) ou encore protéique (lentille,
pois).
●
Beaucoup
de plantes possèdent des fruits charnus qui sont
consommés par les animaux ce qui contribue à la
dispersion des graines qu’ils contiennent.
D Produits de la photosynthèse et interaction avec les autres espèces
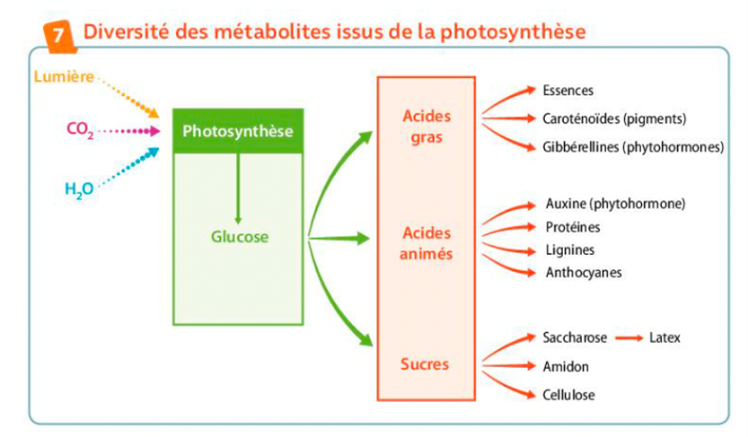
Chez
les plantes, différentes innovations ont été
sélectionné pour limiter l’impact de la
prédation. Par exemple, les tanins repoussent
les phytophages en développant un gout
désagréable et en perturbant la digestion. (En
se liant avec les protéines alimentaires ou avec les enzymes
digestives, ils produisent des précipités aux effets
toxiques ou répulsif). Ce type d’interaction entraine
une compétition entre la survie de la plante et celle de
l’animal : on parle d’interaction
compétitive.
La
vie fixée pose problème pour le rapprochement des
gamètes (voir chapitre 3). Ainsi des molécules comme les anthocyanes vont favoriser la reproduction en attirant
les pollinisateurs avec des fleurs aux couleurs attractives. Ce type
d’interaction apporte un bénéfice à la
plante et à l’animal : on parle d’interaction
mutualiste.
Ces différentes molécules produites par les plantes peuvent être stockées dans des structures internes aux cellules comme les amyloplastes (amidon) ou dans les vacuoles (anthocyanes et tanins).