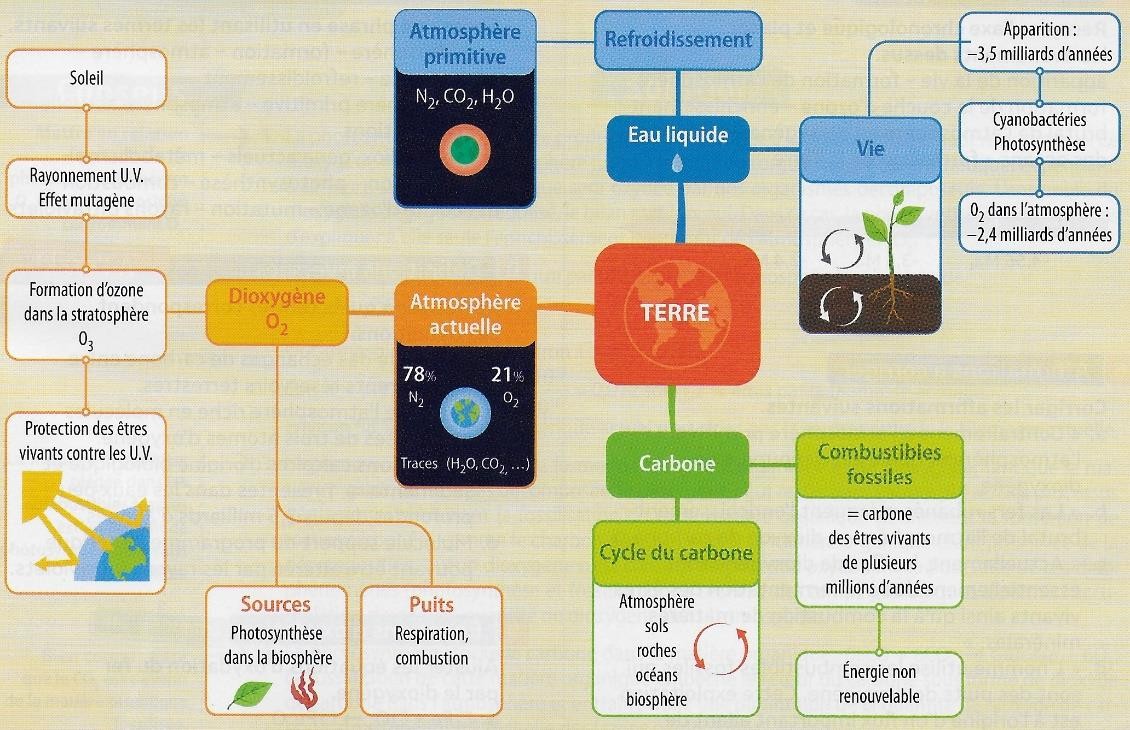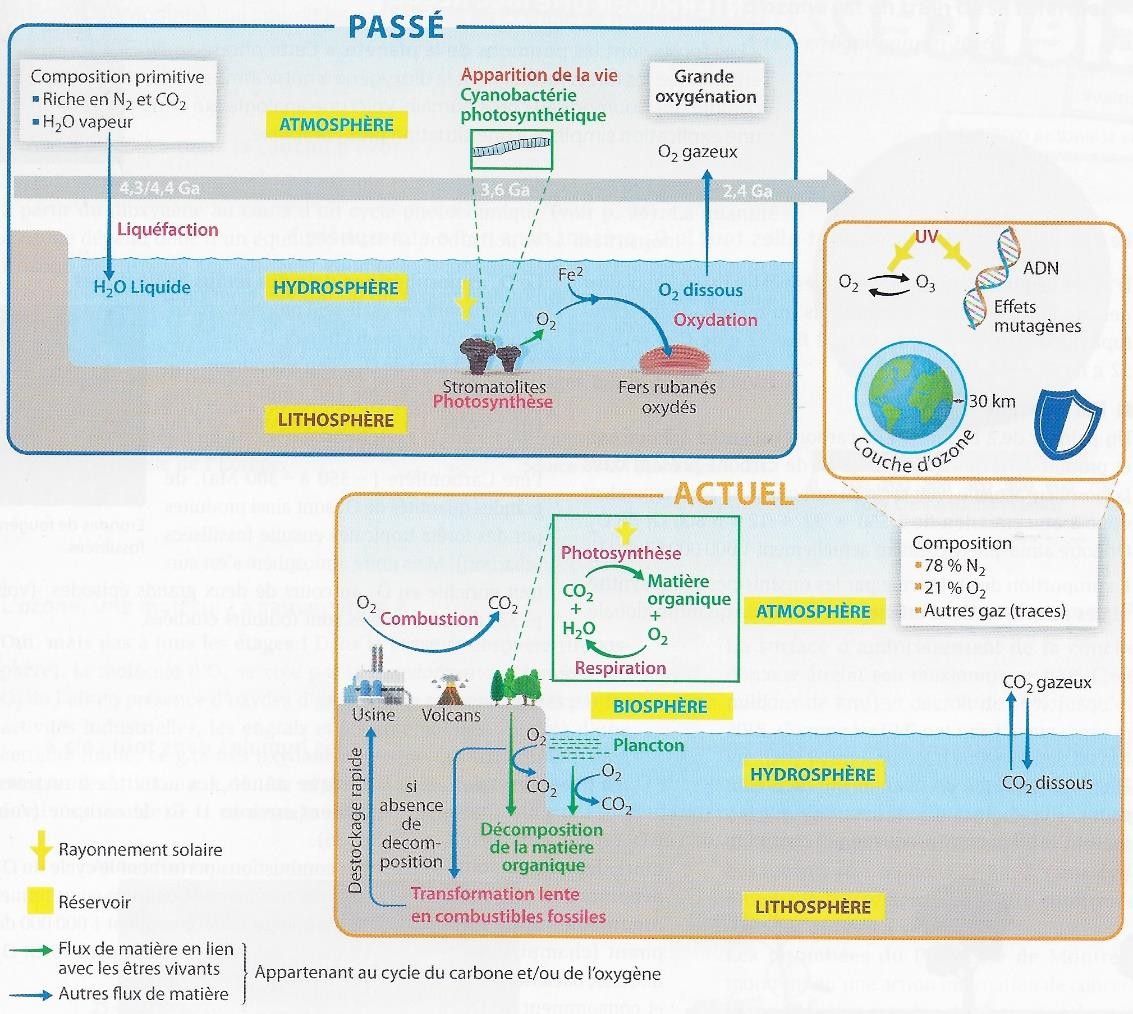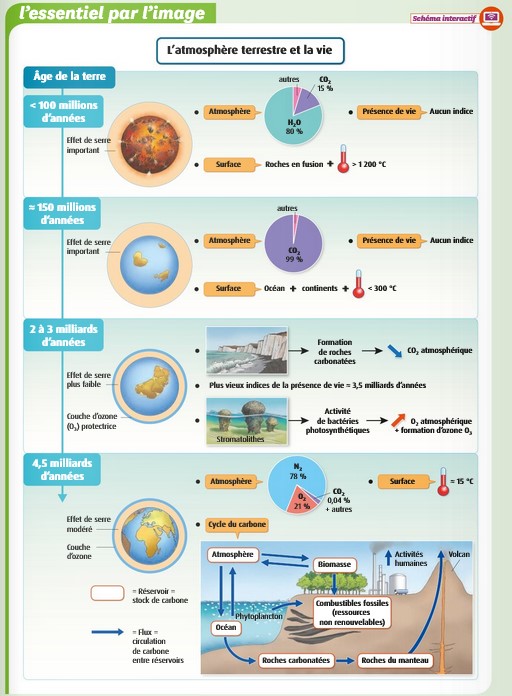Chapitre 1 : L’atmosphère terrestre et la vie
La Terre est
la seule planète que l’on sait habitée.
Le développement de la vie est le résultat
de la
conjonction de nombreux facteurs
astronomiques et physico-chimiques ayant rendu possible
la
présence d’eau
liquide. Un équilibre fragile est atteint permettant le maintien de cette
vie sur Terre.
Problèmes : comment a évolué l’atmosphère terrestre au cours de
l’histoire de la Terre. Quelles conditions ont permis à la vie de s’établir
et de se maintenir.
1. La formation de l’atmosphère primitive.
L’origine
de l’atmosphère est liée à celle de la Terre. Comme toutes les planètes
du système solaire,
la Terre s’est formée par accrétion de divers
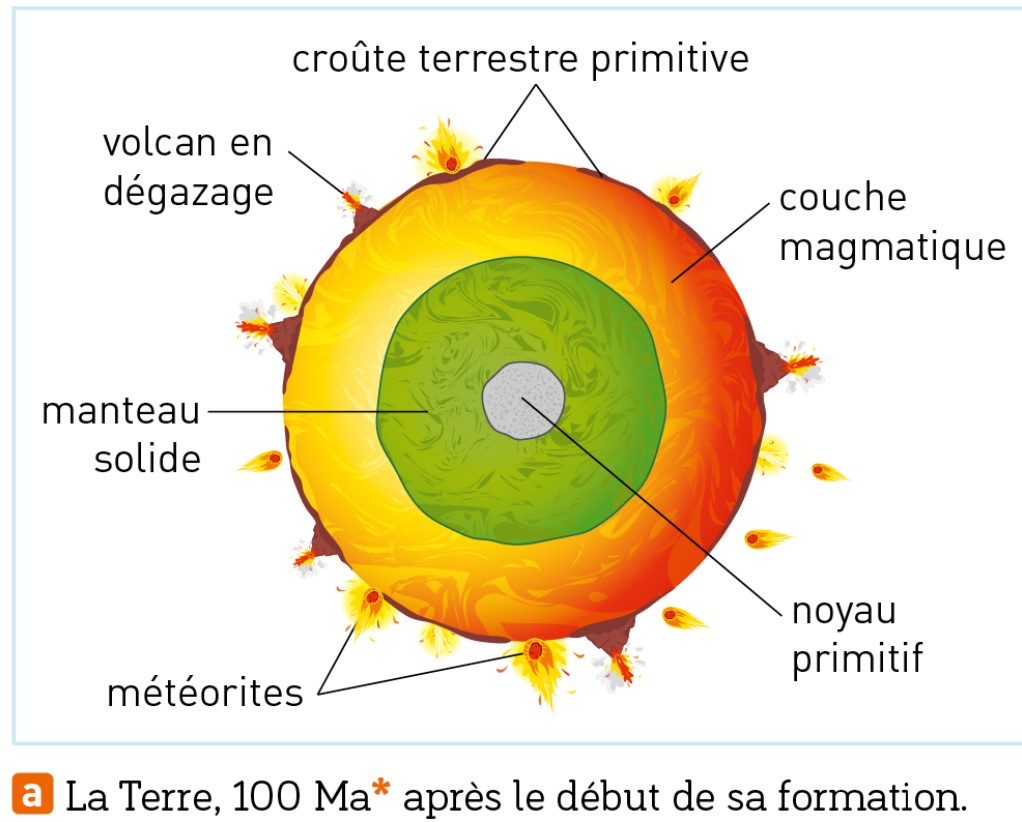
2. L’atmosphère et la vie ont évolué conjointement.
Une fois l’hydrosphère formée,
la vie est apparue
puis s’est
Capables de réaliser la photosynthèse,
ces cyanobactéries fossiles sont les
premiers producteurs de dioxygène connus.
FeO(OH) + H2O → Fe(OH)3
Fe2+(aq) + 2 OH–(aq) -> Fe(OH)2(s)
En précipitant, ce fer a contribué a donnée naissance à des roches

Les fers rubanés (Banded Iron Formation) de l'Archéen de Barberton, groupe de Fig Tree (-3,26 à -3,22 Ga), Afrique du Sud
Lorsque tout le fer présent
dans les océans a précipité, le dioxygène s’est
peu à peu libéré dans l’atmosphère.
Son apparition dans cette dernière
est datée de -2,2 Ga. Il s’est progressivement accumulé jusqu’à atteindre sa concentration actuelle vers -0,5 Ga.
De nos jours, la photosynthèse constitue la principale source de dioxygène atmosphérique tandis que la respiration et les combustions sont les principaux puits de dioxygène.
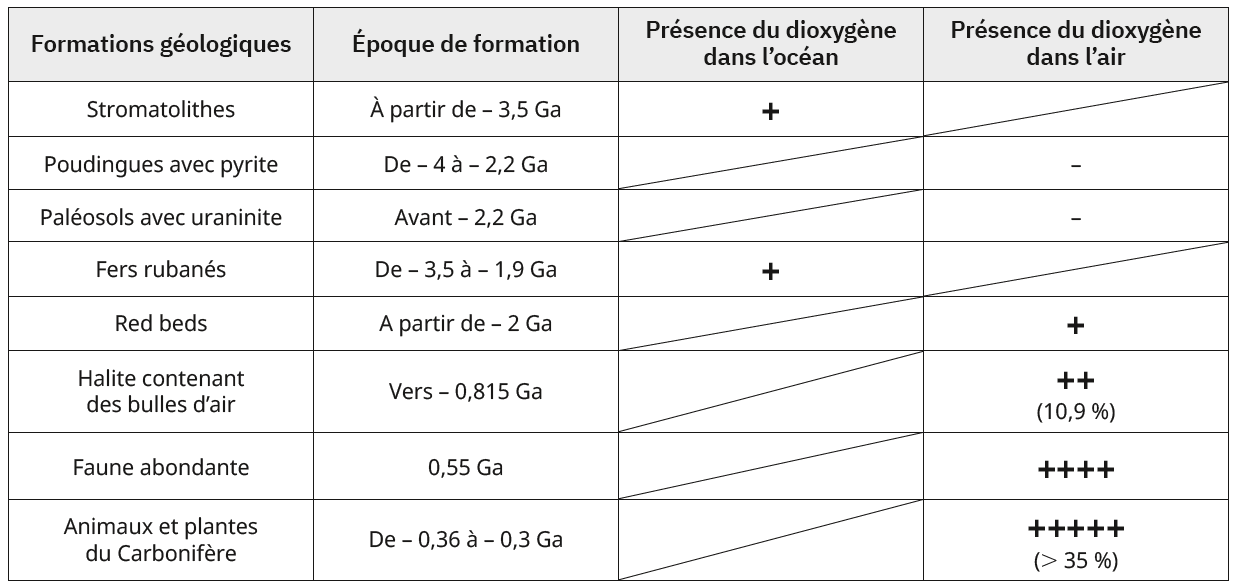
3. La couche d'ozone protège le vivant
L’ozone se forme à partir du dioxygène dans la stratosphère, entre 15 et 50 km d’altitude. Sous
4. Les activités humaines modifient la composition de l'atmosphère
- L’élément carbone
est présent dans différents réservoirs (atmosphère, océans,
sol, biosphère, roches) qui
s’échangent principalement le carbone sous forme de CO2. Ces échanges constituent le cycle biogéochimique du carbone sur Terre.
- Les quantités de carbone
dans les réservoirs restent constantes lorsque
les flux sont équilibrés.
- Or, en utilisant les combustibles fossiles,
les activités humaines
augmentent le rejet de CO2 dans l’atmosphère. Ce
rejet rapide n’est pas compensé par la formation de pétrole, de gaz naturel ou
de charbon, car leur fabrication requiert des millions d’années.
- Ainsi l’Homme restitue très rapidement dans l’atmosphère le CO2 que la nature avait lentement piégé.